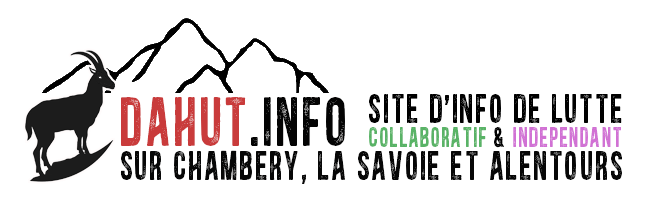L’addiction européenne aux pesticides : une faiblesse politique
En Europe, comme dans le monde, l’utilisation des produits agrochimiques est en hausse. Les géants du secteur
grandissent ainsi que leur pouvoir politique. Trois d’entre eux possèdent plus de la moitié des parts de marché du
secteur et ont un réel pouvoir d’influence sur les gouvernements.
L’Europe cliente fidèle
Malgré plusieurs combats nationaux, mais aussi européens, contre l’utilisation des pesticides, les effets sont presque invisibles.
L’industrie phytosanitaire est devenue, au fil du temps, un pilier essentiel des productions céréalières et maraîchères européennes. Elle garantit des rendements sans lesquels l’Europe ne pourrait se nourrir ni faire commerce de ses produits agricoles.
Aussi, virtuellement, les 27 pays de l’union y ont recours à plus ou moins grande échelle et sont clients des industriels de la chimie comme Bayer, Syngenta ou BASF.
Ces derniers produisent des engrais, des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou encore des pesticides que les agriculteurs utilisent au quotidien.
En 2010 la moyenne européenne de kilogrammes de pesticides utilisés par hectares était à 2,8, en 2025 elle est à 2,7.
Afin de remettre ce chiffre en perspective, notons que l’Europe possède 155 millions d’hectares de cultures. Elle utilisait donc 434 000 tonnes de pesticides en 2010, contre 418 500 en 2025, soit une baisse de 15 500 tonnes en 15 ans.
De quoi donner une idée de l’importance du marché de l’agrochimie rien qu’en Europe.
L‘insuffisance de la solution politique
En 15 ans, la consommation reste donc relativement stable. Pourtant certains pesticides ont bel et bien été interdits, notamment en France. Mais souvent cela équivaut à botter en touche plus qu'à réellement réduire concrètement l'utilisation de produits phyto. En 2022 sur l’interdiction du glyphosate, Emmanuel Macron disait :
« Cela ne marche pas si on le fait tout seul. Je ne peux pas mettre les agriculteurs dans des impasses et sans solutions. ».
Une sortie que l’Observatoire des Politiques Publiques Université Paris-Est Créteil (OPPEC) décrypte :
« Sa vision actuelle est d’interdire uniquement là où il y a des alternatives. »
Par endroit, les pesticides interdits sont donc remplacés par d’autres. Ailleurs, le gouvernement peut accorder des dérogations. Par exemple, la loi biodiversité de 2016 voulait interdire l’utilisation des néonicotinoïdes à partir de 2018. Mais en 2020, le gouvernement fait volteface et déclare les exploitations de betterave sucrière exemptent de cette restriction.
Corinne Lepage, ex-ministre de l’Environnement, dénonçait la tactique du gouvernement pour « complaire au lobby betterave ».
Maintenant, et en partie à cause des lobbys, c’est la loi entière qui est remise en question, avec la levée de bouclier qu’on connait.
Les lobbys derrière la loi Duplomb, quelle efficacité ?
On connait la puissance du lobby de la viande ou du tabac. On connait cependant moins celui du phytosanitaire et des pesticides.
Pour rappel, un lobby est un groupe de pression dont le but est de discrètement influencer la réglementation ou la législation en sa faveur.
Un de ses éminents représentant en France, Phyteis, est suffisamment influent pour que son discours soit repris pour justifier l’intérêt de la loi Duplomb. Un succès politique, que les lobbys transforment en succès économiques impressionnants pour un oligopole surpuissant.
Les Allemands Bayer et BASF, ainsi que les Suisses de Syngenta, sont les principales firmes agrochimiques du monde en termes de chiffres d’affaires, loin devant leur concurrence.
En 2024 selon Agropages, Syngenta crop protection, la filière agrochimique de Syngenta, réalisait 15,433 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Bayer Cropscience générait 11,919 milliards et BASF : 8,836 milliards.
A eux trois, ces industriels représentaient plus de 60% de part de marché en 2023 selon statista.
Par leur taille, les grands acteurs de l’agrochimie sont capables d’absorber d’autres entreprises et de créer un véritable oligopole du phytosanitaire. A l’instar des GAFAM dans le monde de la tech, plus aucune concurrence ne pourra les déloger. Quel avenir a la lutte contre les pesticides si des groupes de pression indéboulonnables et promouvant des produits phytosanitaires ont l’oreille de nos gouvernements ?
Allez plus loin : https://fr.boell.org/sites/default/files/2023-05/atlas-des-pesticides-2023.pdf
Publié le : 31 août 2025 21:17
Pollen